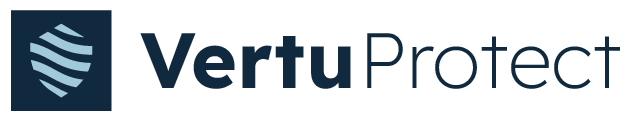Analyse des recours juridiques en Europe
Face à la multiplication des inondations catastrophiques en Europe, de plus en plus de citoyens se tournent vers la justice pour tenir leurs gouvernements responsables de leur inaction climatique. Cette tendance marque un tournant décisif dans la lutte contre le changement climatique. Découvrons ensemble les fondements juridiques, les cas emblématiques et les perspectives d’avenir de ces recours climatiques.
Le cadre juridique des recours climatiques
La reconnaissance du droit à un environnement sain
La protection contre les effets du changement climatique est désormais reconnue comme un droit humain fondamental par plusieurs juridictions européennes. Cette évolution juridique majeure s’appuie sur des droits préexistants comme le droit à la vie, à la santé et à la vie privée et familiale.
En avril 2023, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rendu une décision historique dans l’affaire « KlimaSeniorinnen c. Suisse », reconnaissant que la protection climatique relève des droits humains fondamentaux. Cette décision crée un précédent pour près de 50 gouvernements représentant environ 700 millions de personnes.
Les bases légales des poursuites
Les recours climatiques s’appuient généralement sur trois fondements juridiques principaux :
-
Les engagements internationaux : L’Accord de Paris de 2015, qui fixe l’objectif de limiter le réchauffement climatique à 1,5°C, constitue une référence juridique essentielle.
-
Les législations nationales : De nombreux pays européens ont adopté des lois climatiques fixant des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre.
-
Les droits fondamentaux : Les plaignants invoquent souvent la violation de droits constitutionnels ou conventionnels, comme le droit à la vie ou à un environnement sain.
« La crise climatique est une crise des droits humains. Les gouvernements ont l’obligation légale de protéger leurs citoyens contre ses effets dévastateurs. » – Gerry Liston, avocat principal de GLAN (Global Legal Action Network)
Les cas emblématiques en Europe
L’affaire des jeunes Portugais : un procès historique
L’un des cas les plus retentissants est celui de six jeunes Portugais, âgés de 11 à 24 ans, qui ont poursuivi 32 pays européens devant la CEDH pour leur inaction face au changement climatique. Cette affaire, connue sous le nom de « Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres États », représente le premier litige climatique transfrontalier à cette échelle.
Ces jeunes activistes affirment que les politiques climatiques insuffisantes des gouvernements européens violent directement leurs droits humains. Ils témoignent que les vagues de chaleur et les incendies de forêt au Portugal limitent leur capacité à dormir, à faire de l’exercice, et nuisent à leur santé physique et mentale.
Martim Duarte Agostinho, 20 ans, l’un des plaignants, explique : « Les incendies sont très proches de l’endroit où je vis. Des incendies qui ont déjà mis ma vie et celle de mes sœurs en danger. Des journées d’école ont été perdues à cause de l’une de mes maladies respiratoires mineures. »
L’Affaire du Siècle en France
En France, « L’Affaire du Siècle » constitue un précédent juridique majeur. En 2021, le tribunal administratif de Paris a reconnu l’État français coupable de « carences fautives » dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cette décision a été confirmée en appel en octobre 2022.
Suite à cette condamnation, en avril 2025, onze personnes et trois ONG (Greenpeace, Oxfam et Notre affaire à tous) ont lancé un nouveau recours contre l’État français, cette fois pour manque d’adaptation au changement climatique. Parmi les plaignants figurent des victimes directes des conséquences du changement climatique, dont des personnes touchées par les inondations.
Le cas irlandais : trois générations unies
En septembre 2024, un grand-père, un jeune militant et un enfant en bas âge ont intenté une action en justice contre le gouvernement irlandais pour son inaction face à la crise climatique. Cette plainte intergénérationnelle, déposée par le centre de droit communautaire irlandais « Community Law & Mediation », affirme que le gouvernement enfreint la loi climatique nationale et viole la Convention européenne des droits de l’homme.
Rose Wall, directrice générale de Community Law & Mediation, souligne : « Cette action en justice est intentée au nom des communautés qui seront les plus touchées par le changement climatique mais qui ont le moins de ressources pour y faire face. »
L’affaire des femmes suisses
En Suisse, l’association « KlimaSeniorinnen » (Les Aînées pour le climat), regroupant plus de 2000 femmes âgées de plus de 65 ans, a poursuivi le gouvernement suisse pour inaction climatique. Elles ont argumenté que leur groupe d’âge est particulièrement vulnérable aux vagues de chaleur exacerbées par le changement climatique.
Après avoir épuisé les recours nationaux, elles ont porté leur affaire devant la CEDH, qui leur a donné raison en avril 2023, créant ainsi un précédent historique en reconnaissant la protection climatique comme un droit humain.
Les inondations comme catalyseur d’action juridique
Le cas emblématique de Jérôme Sergent
Jérôme Sergent, agriculteur à Rumilly dans le Pas-de-Calais, est l’un des plaignants dans le recours français de 2025. Sa ferme a été inondée huit fois entre novembre 2023 et mars 2024, entraînant la perte de volailles, de matériel, et l’impossibilité d’accéder à ses terrains pendant presque deux mois.
Il témoigne : « Quand on est arrivés ici, on savait qu’il y avait un risque. Il y avait déjà eu des inondations en 2002 et on nous a dit que tout avait été fait pour nous protéger de ça. On était confiants, des champs d’inondations contrôlées ont été installés le long de l’Aa. Mais aujourd’hui, les ouvrages dimensionnés par rapport à la crue de 2002 ne suffisent pas. On parlait de crue centennale, là on parle de crue millénaire. C’est quoi le prochain superlatif ? »
Les inondations catastrophiques en Europe
Les inondations dévastatrices qui ont frappé l’Europe ces dernières années ont souvent servi de déclencheur pour ces actions en justice :
-
Allemagne et Belgique (2021) : Les inondations de juillet 2021 ont causé plus de 200 morts et des milliards d’euros de dégâts. Suite à cette catastrophe, plusieurs recours ont été déposés contre les gouvernements pour négligence dans la prévention et l’adaptation au changement climatique.
-
Italie, Grèce et Slovénie (2023) : Des précipitations extrêmes ont provoqué des inondations catastrophiques dans ces pays, renforçant la détermination des citoyens à tenir leurs gouvernements responsables.
-
Espagne (2022-2023) : La région de Valence a connu des inondations dévastatrices, suivies de périodes de sécheresse intense, illustrant l’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes liée au changement climatique.
Les défis et obstacles juridiques
La question du lien de causalité
L’un des principaux défis juridiques dans ces affaires est d’établir un lien de causalité direct entre l’inaction gouvernementale et les dommages subis par les plaignants. Les gouvernements défendeurs affirment souvent que les plaignants n’ont pas fourni de preuves suffisantes de ce lien.
Cependant, les avancées scientifiques récentes facilitent cette démonstration. Le sixième rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) établit clairement que le changement climatique anthropique augmente la fréquence et l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, dont les inondations.
La responsabilité transfrontalière
Un autre obstacle majeur concerne la responsabilité transfrontalière. Les gouvernements contestent souvent leur obligation de protéger les droits humains des citoyens au-delà de leurs propres juridictions.
Dans l’affaire des jeunes Portugais, les 32 pays défendeurs ont argumenté qu’ils ne pouvaient être tenus responsables des effets du changement climatique au Portugal. Cependant, des décisions antérieures de la CEDH indiquent que les pays peuvent être responsables des droits humains des personnes en dehors de leurs frontières dans des « cas exceptionnels ».
Les délais judiciaires face à l’urgence climatique
La lenteur des procédures judiciaires constitue un obstacle significatif face à l’urgence de la crise climatique. Les recours peuvent prendre plusieurs années avant d’aboutir à une décision finale, alors que les effets du changement climatique s’intensifient rapidement.
Comme le souligne Kate Higham, chargée de politique à l’Institut Grantham de la London School of Economics : « L’horloge tourne concernant le changement climatique. Les voies juridiques vers la justice pour les personnes affectées doivent devenir plus rapides, moins coûteuses et plus efficaces. »
L’impact sur les politiques publiques
Une pression croissante sur les gouvernements
L’augmentation des litiges climatiques exerce une pression significative sur les gouvernements pour qu’ils adoptent des politiques climatiques plus ambitieuses. Depuis 2018, les poursuites liées au changement climatique ont augmenté de près de 40% à l’échelle mondiale, avec 230 cas déposés rien qu’en 2023.
Cette tendance oblige les gouvernements à reconsidérer leurs engagements climatiques et à accélérer la mise en œuvre de mesures d’atténuation et d’adaptation.
Des décisions judiciaires contraignantes
Les décisions favorables aux plaignants peuvent contraindre les gouvernements à adopter des mesures concrètes. Par exemple, suite à « L’Affaire du Siècle » en France, l’État a été condamné à réparer le « préjudice écologique » causé par le non-respect de ses engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Ces décisions créent des précédents juridiques qui peuvent être invoqués dans d’autres affaires, renforçant ainsi progressivement le cadre juridique de la lutte contre le changement climatique.
L’adaptation aux inondations comme obligation légale
Les recours climatiques contribuent à faire reconnaître l’adaptation aux inondations comme une obligation légale des États. Les plaignants dans ces affaires ne réclament généralement pas d’indemnisations personnelles, mais exigent que l’État prenne ses responsabilités pour protéger sa population, notamment par :
-
L’élaboration de plans d’action concrets à court, moyen et long terme concernant les risques d’inondation
-
L’adaptation des infrastructures et des bâtiments
-
Le financement adéquat de ces mesures d’adaptation
Perspectives d’avenir
L’évolution de la jurisprudence climatique
La jurisprudence en matière de litiges climatiques évolue rapidement. Les décisions récentes, comme celle de la CEDH dans l’affaire « KlimaSeniorinnen c. Suisse », créent des précédents qui renforcent la position juridique des plaignants dans les futures affaires.
Selon Cléo Moreno, juriste chez Greenpeace France : « Ce sera la première fois qu’un État européen est attaqué par des citoyens sur le fondement du défaut d’adaptation. Cette affaire pourrait marquer un tournant dans la jurisprudence climatique européenne. »
L’élargissement des recours possibles
À mesure que les effets du changement climatique s’intensifient, nous pouvons nous attendre à voir davantage de recours juridiques liés spécifiquement aux inondations et autres catastrophes naturelles. Ces recours pourraient cibler non seulement les États, mais aussi les collectivités territoriales et les entreprises contribuant significativement aux émissions de gaz à effet de serre.
Le rôle croissant de la science dans les litiges
Les avancées scientifiques en matière d’attribution des événements météorologiques extrêmes au changement climatique jouent un rôle croissant dans les litiges climatiques. Des études récentes permettent d’établir avec une précision croissante la contribution du changement climatique à l’intensification des inondations.
Ces avancées scientifiques renforcent la capacité des plaignants à établir le lien de causalité entre l’inaction climatique et les dommages subis, un élément crucial pour le succès de ces recours.
Conclusion
Les recours juridiques contre les États pour inaction climatique suite aux inondations représentent une évolution significative dans la lutte contre le changement climatique. Ils permettent aux citoyens de tenir leurs gouvernements responsables de leurs engagements climatiques et de les contraindre à agir concrètement pour protéger leurs populations.
La reconnaissance progressive par les tribunaux européens du lien entre changement climatique et droits humains ouvre la voie à une nouvelle ère de responsabilité gouvernementale. Les cas emblématiques comme celui des jeunes Portugais ou « L’Affaire du Siècle » en France montrent que les citoyens, y compris les plus jeunes, peuvent jouer un rôle crucial dans cette lutte.
Comme l’a souligné Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe : « Le temps est venu de passer des paroles aux actes. Nous savons qu’il existe de nombreuses résolutions, de nombreuses conventions, de merveilleux mots sur papier. Mais l’action fait défaut. »
Face à l’urgence climatique et à l’augmentation des catastrophes naturelles comme les inondations, les citoyens européens disposent désormais d’un outil puissant : le droit de tenir leurs gouvernements responsables devant les tribunaux. Cette évolution juridique pourrait accélérer considérablement la transition vers un avenir plus durable et résilient face au changement climatique.
FAQ
Quels pays européens ont déjà été condamnés pour inaction climatique ?
Plusieurs pays européens ont déjà été condamnés, notamment les Pays-Bas dans l’affaire Urgenda (2019), la France dans « L’Affaire du Siècle » (2021), et l’Allemagne par sa Cour constitutionnelle (2021).
Quels types de dommages peuvent être invoqués dans ces recours ?
Les plaignants peuvent invoquer des dommages matériels (destruction de biens, pertes économiques), des dommages corporels (problèmes de santé liés aux catastrophes), des dommages moraux (anxiété climatique), et le préjudice écologique.
Les entreprises peuvent-elles aussi être poursuivies pour leur contribution au changement climatique ?
Oui, les entreprises font également l’objet de recours climatiques. Par exemple, Shell a été condamnée par un tribunal néerlandais en 2021 à réduire ses émissions de CO2 de 45% d’ici 2030.
Comment prouver le lien entre les inondations et le changement climatique devant un tribunal ?
Les plaignants s’appuient sur des études scientifiques d’attribution, qui évaluent dans quelle mesure le changement climatique a augmenté la probabilité ou l’intensité d’un événement météorologique spécifique. Les rapports du GIEC constituent également des preuves scientifiques solides.
Ces recours peuvent-ils vraiment changer les politiques climatiques des États ?
Oui, ces recours ont déjà conduit à des changements concrets. Aux Pays-Bas, suite à l’affaire Urgenda, le gouvernement a dû adopter des mesures supplémentaires pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, notamment la fermeture anticipée de centrales à charbon.